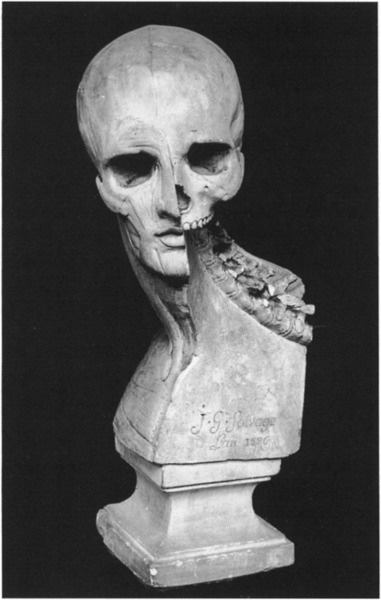poulix
Mode Lecture -
Citer - 24/04/2011 18:53:16
poulix
Mode Lecture -
Citer - 24/04/2011 18:53:16
*´¨ )
,.•´¸.•*¨)
¸.•*¨) (¸.•´ :
(¸.•´ : (´¸.•*´¯`*•.¸.•*´¯`*•
Un soir de mai, je partirai.
Un soir, elle avait décidé de partir. C'était un mois de mai. On prend toujours les grandes décisions avant l'été. Les mois de mai, sur la terre comme dans le ciel, l'air se fait plus dense, il vibre d'une énergie nouvelle. À cette saison, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir très loin. Les distances semblent se rétracter sous la texture de l'air. En mai, l'air a quelque chose du cristal, de sa transparence, de sa pureté et de son chant invisible. L'atmosphère a perdu l'opacité de l'hiver et ce que l'on ne percevait que dans un brouillard un peu flou, les yeux comme embués de neige, se révèle à nous. Limpide. Mai, c'est le mois où l'on a déjà oublié que la verdure des arbres vient de naître et que la chaleur n'a pas toujours été. C'est le mois où l'on ne pense pas encore à l'automne, à la rentrée des classes, aux cartables rouges et bleus qui fleurissent dans les livres de lecture. En mai, la vie a quelque chose d'insaisissable, elle explose en nous, tournoie et nous prend par la main. Le froid qui nous habite parfois vibre un peu et s'en va. En courant. Comme les lutins des bois. Furtivement. Et l'envie prend sa place. C'est l'époque où rien n'est impossible.
On prend toujours les grandes décisions avant l'été. Et elle avait décidé de partir.
Partir. Il est des langues où l'on ne prononce pas ce mot de la même manière selon l'intensité qu'on lui accorde. Partir porte en lui un infinité de variations. De la plus futile à la plus décisive. On peut partir le temps d'une respiration, partir pour toujours ou bien à jamais, partir en vrille ou pour l'aventure, partir un jour. Avec ou sans retour. Elle n'avait pas eu à choisir entre deux mots d'un dictionnaire. La langue française n'en possède qu'un. Mais lorsqu'elle m'avait dit qu'elle partait j'avais tout de suite compris de quel mot il s'agissait. C'était un soir de mai.
Nous étions assises sur les pavés. Il faisait juste assez lourd pour que nous ne nous envolions pas. Et juste assez frais pour que les étoiles ne fondent pas. Nous étions ensemble, comme souvent, drapées dans le silence de nos propres phrases. Elle était la seule avec qui l'on pouvait parler sans rien dire. Les gestes et les regards faisaient partie de son langage. Nous étions assises sur les pavés, adossées contre un mur de brique. Il faisait lourd et quelques jupes passaient devant nous en un bruissement printanier. Certains regards perçaient notre silence d'une question cachée. Qui était ces deux jeunes filles, l'air perdues dans leurs pensées ? D'où venaient-elles ? Où allaient-elles ? Que faisaient-elles, dans la rue, un soir de mai ? Et toutes ces questions ne furent jamais prononcées parce que nous autres, les humains, avons peur d'apprendre à connaître ceux que l'on croise en chemin. Les regards se détournaient et notre image s'effaçait progressivement de leurs rétines. Peut-être n'étions nous que deux mendiantes ou deux gamines en fugue. Peut-être n'étions nous rien. Si elle avait été mendiante, son gobelet de fer rouillé aurait été empli de beauté. La seule chose qu'elle osait demander au monde était un peu de sa poésie, un peu de sa présence. Quelques mots, la courbure d'un sourire, la désinvolture d'un haussement d'épaule. Quelques pas, une intention infime, un peu d'amour semé d'angoisse ou de passion. Elle ne demandait rien au monde car elle avait appris à vivre. Mais elle avait le don d'attirer les offrandes et cela se lisait en elle. Mendiantes ou gamines, nous n'avions pas de raison d'être là plutôt qu'ailleurs. N'importe quel lieu aurait su nous accueillir. Ce bout de rue, avec ses bars d'où filtrait une lumière chaude comme la nuit, bruyante comme la vie, avait autant de valeur à ses yeux qu'un palace, un champ, une place ou un terrain vague. Nous avions passé tant de nuit dans des lieux dont nous ne nous souviendrons jamais. Rien ne comptait si ce n'est l'autre, sa présence et les quelques litres d'air qui nous reliaient. Où que nous soyons, nous avions notre propre univers et je crois que c'était elle qui lui donnait toute sa plénitude. Elle. Elle qui avait décidé de partir. Elle. Avec son regard pur, ses pulls trop grands, son âme d'enfant et sa tendresse. Elle qui avait décidé de partir.
Elle me l'avait dit, ce soir de mai, entre deux bouffées de fumée. Comme ça. Sans prévenir. Comme la plus évidente des respirations. Il faisait sombre et je n'avais pas pu lire le sens de ce mot dans son regard. Ce ne fut que le tremblement infime de la cigarette entre ses doigts qui m'avait permis de comprendre l'importance de ce qu'elle me confiait. Dans la pénombre, le rougeoiement qu'elle venait de raviver en inspirant un peu de nicotine avait chancelé. J'avais alors compris à quel point je tenais à cette gamine, à son âme épurée, à son corps presque trop fragile qui flottait dans ses grands pulls over. On aurait pu se glisser à deux dans ses habits de laine. Il faisait lourd mais elle était habillée comme en hiver avec son regard printanier. On ne pouvait même pas deviner les formes de son corps sous les monceaux de vêtements qui l'habillaient. C'étaient des pulls immenses, comme tricotés pour des géants par les peuples du Nord. Sa bouille aux grands yeux verts et les boucles rousses, presque auburn, de ses cheveux se perdaient dans son col roulé. J'aimais l'odeur de ses châles lorsque nous nous drapions dedans. Ils étaient plus lourd que des couvertures. Ensemble, nous n'avions jamais froid. Souvent, lorsque nous étions assises par terre, elle ramenait ses genoux sous son menton, s'emmitouflait dans son tricot et se blottissait dans ses propres bras. Cette posture était son exact miroir : reflet de ses angoisses, de sa douceur et de la confiance qu'elle avait en sa propre fragilité. Elle était belle sous ses airs de clocharde.
« Je pars, c'est décidé ». On prend toujours les grandes décisions avant l'été.
Sa voix avait à peine tremblé et s'était imprimée dans la nuit en même temps que la vacillement de la braise. Elle avait ouvert une brèche dans notre silence, ce silence que nous avions pris tant de temps à façonner. Des années, des jours, des rires, des nuits, des pleurs, des heures de doutes et de désirs, des instants volés au temps et offerts à la vie, des après-midis au goût de chocolat noir, des soirées peuplées de livres, et des nuits encore, toujours, sans cesse, des promenades sans fin, des paroles, des regards, sa présence, nos passions, nos folies, nos âmes, son corps, le mien, nos joies, la beauté de nos délires, la force de nos soupirs, la présence et le bonheur d'être là ensemble pour rien et pour la vie.
Du moins l'avais-je pensé. Elle aussi. Le rougeoiement de la braise me l'assurait : nous serions toujours ensemble malgré la distance, le temps, les mille chemins qui nous sépareraient. Comme si l'on pouvait croire que sous les mots de mai, les distances se rétractent sous la texture de l'air. La braise avait dansé en un vacillement. Ou bien étaient-ce nos cœurs ? Elle savait faire danser le feu et toutes les nuits que nous avions passées ensemble étaient empreintes de l'odeur entêtante de la fumée. Notre univers flottait dans ce brouillard de tabac qui se consumait sous son souffle. Elle ne prononçait jamais le moindre mot avant d'avoir roulé sa cigarette. Elle avait les doigts fins et mon plus grand plaisir était de l'observer pendant la préparation de cette holocauste. Sa main glissait dans le paquet de tabac pour en saisir une pincée qui me projetait dans un autre monde. Il y avait du soleil, une cannelle trop forte et l'odeur des foins dans cette herbe létale. Il y avait aussi le bruissement du papier à cigarette, léger comme un voile de mariée, le frôlement de ses doigts pour le désunir des autres feuilles. Le mouvement imperceptible du pouce et de l'index qui semaient la mort des champs sur la blancheur. Et cette façon de rouler la cigarette avec la même douceur qu'un homme passant l'anneau au doigt de sa femme. Le coup de langue final était comme un pacte avec la mort, une mort acceptée, douce et lente, dans la jouissance de la dépendance. L'étincelle du briquet unie à la première inspiration marquait la fin de la prière silencieuse. Le ciel noir accueillait alors quelques volutes, un point de feu et une senteur qui hésitait encore entre l'herbe coupée et les champs de goudron incendiés. Nos mots s'égrenaient dans cette ambiance et mourraient comme meurt la fumée. Sans un bruit. Laissant une odeur, une marque invisible là où elle semble avoir disparu.
« Je pars c'est décidé ». Les mois de mai sont peuplés de cicatrices éternelles.
Elle partait. C'était décidé. Et elle partait sans moi. S'il y avait eu une musique dans nos regards qui ne se croisaient pas, je pense qu'elle aurait était douce, triste mais pleine de vie et d'espoir. Il y aurait eu un piano et une mélodie lancinante, grave, se répétant inlassablement. Il y aurait eu un violon, deux violons qui se seraient parlés entre les notes en noir et blanc. A l'infini. Il y aurait eu un rythme qui s'étire dans le temps et s'étend vers l'avenir. Et ce thème qui revient et qui n'a pas de nom. Et ces notes qui glissent comme la larme sur nos joues. Il y aurait eu nos cœurs, à l'unisson ou bien contre le temps, le battement de nos cil et le murmure des rues. Un peu comme une chanson d'automne qui s'invite aux mois de mai. Mais il n'y avait pas de musique, juste la rumeur du bar d'en face et le bruit de quelques talons sur le macadam. Elle partait. Et elle avait raison. Car elle avait en elle, sous ses tendres airs de gamine, une énergie peu commune qu'elle ne pouvait garder en vase clos. Elle aimait la vie et la vie l'aimait. C'était une relation unique qu'elle entretenait avec le monde entier et dont j'avais le chance de faire partie. D'avoir fait partie. Elle bouillonnait, elle vibrait de force, de courage, de compassion et elle savait comprendre les autres et les accepter tels qu'ils s'offraient à elle. Il n'était pas difficile de lui parler. Lorsque l'on croisait son regard, on avait presque envie d'être le châle qui embrassait ses épaules ou cette cigarette entre ses doigts. Se laisser dénuder, construire, façonner par elle. Laisser notre intériorité se dévoiler et exhaler sa profondeur. Sans honte car elle ne jugeait pas. Je lui parlais souvent comme à moi-même. Elle avait cette force et il était temps, en ce mois de mai, qu'elle aille l'exprimer au-delà de la vie qu'elle avait toujours connue.
« Je pars. C'est décidé. Tu peux venir avec moi. »
Mais elle était partie sans moi. J'avais refusé de l'accompagner. Elle a peut-être cru que c'était pour la laisser voler de ses propres ailes, pour la laisser être en dehors de moi. La vérité se lit dans ma lâcheté. Je n'ai jamais eu la force de sa fragilité. Je me sentais bien en sa présence parce qu'elle incarnait ce que je n'arrivais pas à être. On a toujours un modèle, un idéal que l'on s'efforce de suivre dans une vie. Quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, à dépasser ses peurs et délier ses angoisses. On a toujours des envies, des désirs, des mots qui nous sont chers mais auxquels on peine à donner vie. Parfois, on croise un être au détour d'un hasard et cela nous suffit. Souvent, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de vies avant de comprendre comment être soi-même. Bien des fois, elle m'avait aidé sans le savoir. Il lui suffisait de vivre, d'agir naturellement pour me prouver qu'être moi était possible. Notre relation était étrange. Elle m'affirmait que j'étais moi aussi, au travers de ma conception de la vie, ce qui lui permettait d'avancer. Cette fois, elle avancerait d'elle-même puisqu'elle partait sans moi. Je ne savais pas partir ou du moins plus dans le sens où elle l'entendait. J'avais besoin de pouvoir revenir, m'accrocher, rester là où je me sentais bien. L'inconnu me faisait peur. C'est comme se jeter dans le vide, hurler à Dieu qu'on ne le connaît pas, hurler adieu, dire qu'on n'oubliera pas. J'avais toujours eu peur. Enfant, lorsque je rentrais de l'école et que je voyais un passant, ma gorge se nouait. Je l'apercevais au loin, j'anticipais le moment où l'on se rencontrerait, où il faudrait que nos regards se croisent et que mes lèvres articulent un laborieux « bonjour ». C'était un défi qui se reproduisait quasiment chaque jour. Je me forçais mentalement à ne pas détourner les yeux et chaque sourire était une victoire. Jour après jour, j'avais appris à ne plus avoir peur des inconnus de mon village. En ce mois de mai, j'avais encore trop peur du monde pour me laisser emporter dans la vague d'énergie qui était prête à m'engloutir et à me projeter vers l'ivresse de l'inconnu. Non, je ne partirai pas.
« Je pars. J'ai peur tu sais. Viens avec moi. »
Je ne sais pas si elle avait vraiment peur où si c'était une manière de me rassurer. Tout le monde a ses angoisses mais je n'ai jamais tout a fait réussi à cerner les siennes, celles qui se terraient dans le creux de ses cernes. Parfois, la nuit, elle ne dormait pas. Elle restait dans son lit à fixer le plafond ou bien elle tentait de fuir l'insomnie en courant dans les rues vides. Nous nous étions rencontrées une nuit sans sommeil. Il y avait des éclats de craintes dans ses yeux, elle tentait d'échapper à quelque chose qui la poursuivait. Elle avait peur d'elle-même et de ce qui faisait sa force. Elle vivait dans l'angoisse de ne jamais réussir à « vraiment aimer ». Elle s'offrait trop au monde, à l'univers, à l'ensemble des êtres qui peuplent la terre. Elle avait peur de perdre cette force si elle devait un jour concentrer son amour sur une seule personne. Moi-même, elle ne savait pas si elle m'aimait comme elle aimait l'Oiseau ou bien d'un autre mot. Nous avions passé des heures à tenter de défricher le champ de ses craintes. Mais l'herbe folle renaît toujours. Elle était capable d'embrasser un clochard et de sourire aux imbéciles mais elle doutait de sa capacité à faire le bonheur d'un être. C'était pourtant elle qui m'avait appris l'amour. C'est elle qui avait réussi à ouvrir mon regard sans le voiler devant la misère. Tant de fois, depuis toujours, j'avais voulu parler aux hommes qui peuplent les trottoirs. Comme les passants de mon village, les miséreux me faisaient peur. Malgré moi. Elle m'avait appris à ne pas détourner le regard, à leur offrir la conscience d'exister au-delà du tintement d'une pièce de monnaie dans un gobelet de fer rouillé. J'avais compris qu'un mendiant, qu'il réclame sa pitance ou te regarde en silence est avant tout un homme qui voudrait exister. J'avais compris qu'il suffisait parfois d'un sourire, de quelques minutes passées sur un banc à parler du temps ou à se taire pour s'enrichir mutuellement. Car si les hommes ont peur, quelques mots dans la rue ou devant un café brûlant sont parfois le meilleur des remèdes. Elle n'avait jamais eu peur des autres mais on n'échappe pas facilement à la crainte de soi-même. Les jours où son angoisse la reprenait, elle peinait à rouler sa cigarette. Ses mains laissaient tomber un peu d'or brun sur le sol et, alors qu'elle fumait, le petit point rouge chancelait. Lorsque nous parlions, elle laissait la cendre tomber sur ses genoux et parfois, la laine frémissait un peu sous la chaleur des braises. Mais sa détresse se lisait surtout dans le jeu de ses mains. Agrippées l'une à l'autre, comme pour ne pas tomber, comme pour se rassurer, ses doigts se raccrochaient aux anneaux d'argent qui brillaient dans la nuit. L'ongle de son pouce droit s'enfonçait imperceptiblement dans sa chair. Parfois, elle saignait.
« Je pars. J'ai peur, je voudrais te revoir mais je pars. Je pars en Roumanie. On m'attend là-bas »
C'était le dernier mois de mai que je passais avec elle. Elle partait en juin. Elle ne savait pas pour combien de temps mais elle devait partir car des orphelins attendaient sa présence. Elle me quittait pour aller travailler dans un orphelinat. Elle allait rejoindre des dizaines d'enfants misérables, s'imprégner de leurs regards et leur offrir le sien. Elle partait pour apprendre à vivre dans un pays lointain, quelque part où sa force façonnerait des êtres et où son sourire se multiplierait à l'infini dans la crasse et la tristesse. Elle partait, j'avais envie de pleurer mais c'était peut-être de joie. Là-bas, elle pourrait déciller tant de paupières, créer tant de poupées de chiffons et inventer toutes les histoires qui n'existent pas encore. Elle les murmurerait aux enfants et aux cafards dans des dortoirs surpeuplés. Elle courrait dans les terrains vagues derrière un ballon de papier journal. Elle ébourifferait des tignasses emmêlées et nettoierait des peaux mates avec un coin de tissu trempé dans un peu d'eau. Elle leur apprendrait à vivre et ils oublieraient qu'on peut parfois se contenter de survivre.
Ce soir là, je crois que je me suis rendue compte que la vie ne se prévoit pas et que les rencontres sont tissées d'imprévus. J'étais entre la joie et la tristesse, entre l'envie de lui hurler ne t'en vas pas je tiens à toi ne pars pas pas comme ça et celle de la laisser s'en aller dans la nuit. Laisser sa silhouette se fondre dans la rumeur du bar rouge, s'évanouir derrière les briques du mur d'en face.
Elle était parti. Les mois de juin ont en eux la mort d'une saison.
Elle m'avait promis qu'elle m'écrirait. La lettre avait pris du temps à arriver. C'était la première fois que je voyais son écriture mais j'ai tout de suite reconnu la ténacité de son regard et la souplesse de ses boucles rousses. C'était une enveloppe un peu jaunie par le voyage, le soleil et le poussière. J'étais restée longtemps à côté de la boîte aux lettres sans oser l'ouvrir. Qu'allait-elle me dire elle qui parlait si bien avec son corps. Mes doigts tremblaient comme les siens ce soir de mai. Elle avait écrit plusieurs pages d'une écriture déliée. Il y avait des fleurs séchées et des plumes d'oiseau bleu. Elle me contait sa vie, les enfants de là-bas, les sourires de la misère, la crasse du bonheur. Elle avait eu l'intention de leur apprendre le plaisir de la vie mais elle s'était vite rendue compte qu'elle n'en était pas capable. Il était impossible d'offrir la félicité à ces petits êtres chétifs qui n'avaient que la peau sur les os et dont la richesse se réduisait souvent à une agate verte. Elle n'avait pu leur offrir le bonheur car elle avait dû se contenter de le partager. C'était cela qui était le plus beau. Se rendre compte que l'on arrive là-bas, gonflés de notre suffisance et de notre altruisme démesuré, que l'on se rend là-bas en pensant être le salvateur, celui qui les arrachera des griffes d'une tristesse qui n'existe pas. Il y avait des fleurs et des larmes séchées. Et dans ces larmes, la révélation. Prendre conscience que la vie n'est que dans le présent, la possibilité de goûter l'instant pour ce qu'il est et non pour ce qu'il aurait dû être. Vivre dans le monde qui nous est offert en compagnie de ceux qui sont à notre porte. Savoir accepter l'air comme un présent et la douleur comme une épreuve qui nous mènera toujours plus haut. Elle pensait à moi. Les enfants étaient comme elle, effrayés par leur propre vie. Je l'imaginais si bien. Les enfants étaient comme moi, effrayés par la vie des autres. Par cette lettre qu'elle m'envoyait, elle espérait être un peu plus près de moi. Elle m'avait toujours aidée à comprendre le monde et c'était alors qu'elle était au loin qu'elle m'en donnait la clef. Elle resterait dans cet orphelinat. Elle ne reviendrait pas. Ou bien comme les oiseaux, le temps d'une saison. Elle a vagabondé longtemps, laissant au vent le soin de me porter quelques lettres. Puis le vent s'est tari.
Les mois de mai ont passé. Aujourd'hui, je ne sais si la braise chancèlerait sous ses doigts si elle devait me dire qu'elle a décidé de partir. Peut-elle encore seulement le dire ? N'est-elle pas partie à jamais ?
Dans tous les cas, sache que tu vis encore en moi.
Un jour, crois-moi, je partirai, un soir de mai.
*´¨ )
,.•´¸.•*¨)
¸.•*¨) (¸.•´ :
(¸.•´ : (´¸.•*´¯`*•.¸.•*´¯`*•