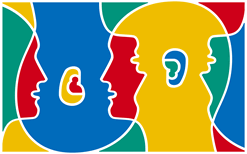(nouvelle publiée dans la revue "vers à lyre", le numéro 13, pour la lire en plus aéré... ( http://www.vers-a-lyre.fr/))
CHEMISE
Ce matin-là, après avoir assommé le réveil, après avoir ouvert les yeux, après les avoir refermés puis ouverts à nouveau, le temps de m’habituer à la lumière, après avoir entrepris, hagard, de faire le chemin jusqu’au placard, après avoir bâillé deux ou trois fois, après avoir attrapé des vêtements propres et posé mes lunettes bien droites sur mon nez de travers, j’ai enfilé la chemise. J’ai dû m’y prendre à trois fois avant de parvenir à faire coïncider chaque bouton avec sa boutonnière. Je crois que je tremblais, aussi. J’ai mis le col comme j’ai pu, j’ai posé la main sur la poignée, froide comme la rosée, j’ai ouvert la porte et je suis allé déjeuner. En voyant la couleur du café j’ai eu peur pour la chemise, j’aurais dû m’habiller après. Je l’ai bu quand même, il était chaud et ça m’a fait du bien. Je suis resté un moment à regarder les formes dans le fond du bol. Je ne sais pas y lire l’avenir, mais parfois j’ai l’impression de deviner des choses. Je trouve ça reposant, de regarder comme ça le marc de café avec le goût dans la bouche et la chaleur dans la gorge. Ça m’apaise. Pourtant j’ai tout de même fini par me lever et le bol s’est retrouvé dans l’évier, rincé, produit-à -vaisselé, cajolé, essuyé, puis il est retourné rutilant vers sa case départ, et à demain matin.
Dans la salle de bain, je me suis passé un gant sur le visage, et je me suis lavé les dents. Dans ma salle de bain, il y a un miroir. J’ai craché le dentifrice. Je me suis rincé la bouche, et c’est en relevant la tête que j’ai croisé mon regard. A chaque fois ça me surprend, ce sourcil à gauche plus haut et plus hérissé que celui de droite. Quand on ne regarde que les yeux, ça ne se voit plus. Mais tout de même, le regard que mon miroir posait sur moi n’était pas très flatteur. Je me suis reculé un peu, pour m’examiner. Globalement, ce n’était pas dramatique. Sans aller jusqu’à avoir de l’allure, j’étais présentable. J’ai souri un peu, pour voir le sourire que je lui offrirai tout à l’heure. Il était légèrement crispé, mais avec un peu de spontanéité il n’y paraîtrait plus. Et puis ce pli a attiré mon regard. Là, droit et franc, comme un trait rageur sur une mauvaise copie, il s’étirait de l’aisselle au plexus, où il s’arrêtait net. J’ai froncé les sourcils et j’ai lissé le pli. Un coriace, celui-là. Il était si mal placé qu’on ne voyait que lui. L’homme dans le miroir avait un air narquois. J’ai ôté la chemise et j’ai pris le fer à repasser. Il faut dire que je suis un génie du fer à repasser. Quelques allers-retours souples et le pli déclarait forfait. J’ai remis la chemise et j’ai défié le miroir. Je n’avais jamais remarqué à quel point cette chemise faisait des plis. On aurait dit qu’elle le faisait exprès.
Quand j’en chassais un, deux autres me narguaient. Pire que tout, on voyait encore, imprimée sur le tissu bleu, si évidente, la cicatrice du pli que j’avais cru vaincre. Cette balafre était de loin la plus affreuse, elle semblait dire « Cet homme a cru triompher de moi. Il en portera la marque à jamais ». Le miroir me jetait un regard courroucé. Et toutes ces petites vallées, tous ces bourrelets et ces froissements, c’est comme s’ils rayonnaient depuis le pli originel, le grand pli irréductible, la marque du désordre. J’ai tout repassé, trois fois. Sans y croire, je dois dire. Chaque fois, mon reflet me renvoyait avec effroi cette image de moi tout froissé, négligé, ce vêtement ridé, comme refusant d’épouser la forme de mon corps. J’ai tenté de mettre une autre chemise, celle-là je n’aurais jamais dû la trouver, j’aurais dû la jeter depuis longtemps. Mais ça n’allait pas, ça n’allait jamais, ce n’était pas ce qu’il fallait, pas ce que je voulais. C’était avec cette chemise qu’elle m’avait vu la première fois, et ce devait être celle-ci pour aujourd’hui, aucune autre. Comme un chien revient vers un maître qui le bat, je la passai à nouveau. Les boutons venaient tout seuls, si familiers sous mes doigts, le col était déjà mis, je n’avais plus rien à faire. Et toujours ce champ de bataille au lieu de l’apparence soignée que j’aurais tant voulu revêtir. J’ai mis un pull par-dessus, j’ai caché mon échec. Mais il m’a semblé encore voir le sillon, si constant, si tranquille, qui courait de ce point à cet autre, immobile, impassible. Il voulait me ridiculiser. J’ai retiré le pull. Il faisait trop chaud. La chemise me serrait. Avais-je grossi ? Les plis me brûlaient, la peau du torse me démangeait et je n’osais pas me gratter de peur de l’abîmer encore. La chemise. Je n’osais pas sortir. Une remarque d’elle, un regard appuyé dans la rue, un miroir de trop au détour d’une boutique, et j’aurais éclaté. Je le savais. Le réveil a sonné à nouveau. C’était l’heure de partir. Je lui ai écrasé mon poing sur la figure. J’ai voulu sortir de chez moi mais dans la vitre de la porte d’entrée, le reflet me guettait. Le reflet de la chemise. Je n’ai pas pu le dépasser. J’ai arraché la chemise, un bouton s’est cassé, je l’ai jetée violemment mais elle est retombée tout doucement. Je l’ai enfoncée dans un sac poubelle et je suis sorti torse nu la mettre aux ordures. Je pleurais, je crois. J’étais en retard. J’étais foutu. Jamais elle ne voudrait me revoir…